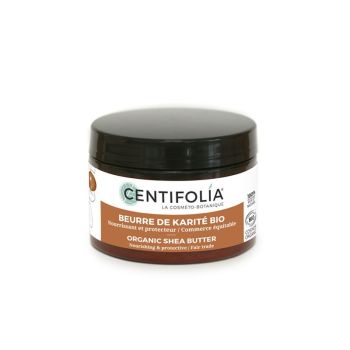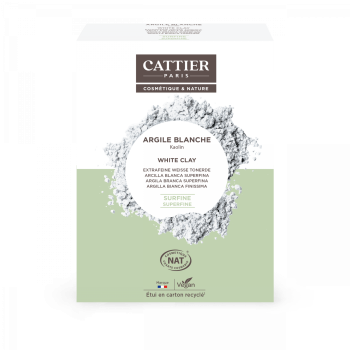Paiement sécurisé
Par carte bancaire,
via Paypal ou par chèque

Livraison dès 3.99€
À votre domicile, en Point Relais
ou en click & collect

Livraison offerte
dès 69€ d’achat
en Mondial Relay

Conseils de pharmacien
au 04 76 77 23 08
du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h30

Points de fidélité
Cumulez des points
ou parrainez un ami
pour bénéficier d’offres spéciales